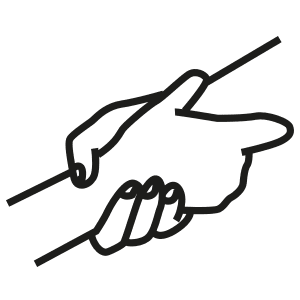Une histoire de la culture à Genève tributaire de sa contestation
L’histoire culturelle de la ville de Genève est fortement tributaire de ses marges. En effet, un important mouvement de culture oppositionnelle a marqué la ville depuis les années 1960 et structure encore aujourd’hui largement la vie culturelle genevoise. Certains lieux emblématiques ont vu le jour dans le cadre de mobilisations contre-culturelles qui ont par ailleurs laissé de profondes traces dans la mémoire collective genevoise. La vie culturelle y est ainsi travaillée par une mise en récit de la culture alternative et de la mémoire d’un désormais mythique « mouvement squat ». L’association de ces deux éléments, fortement articulés, participe dès lors de la production urbaine genevoise à travers son cadre bâti, ses institutions culturelles et la mémoire de ses habitant·e·s.
En repartant d’une enquête collective Pour une restitution de notre enquête, voir notamment L. Pattaroni (dir.), La contreculture domestiquée. Art, espace et politique dans la ville gentrifiée, Genève, MétisPresses, 2021., menée entre Genève et Lisbonne avec nos collègues du Laboratoire de sociologie urbaine de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, il s’agit ici de souligner la dimension spatiale des politiques de l’art et quelques pistes d’émancipation qui s’ouvrent avec la production de lieux de cultures autonomes. Nous défendons l’idée selon laquelle la production de tels lieux déplace des lignes dans les formes d’émancipation frayées par l’art. En effet, dans la mesure où ils sont à même d’articuler l’efficacité des régimes esthétiques à celle de l’autogestion dans la production des espaces, ces lieux reconfigurent « les cadres sensibles au sein desquels se définissent des objets communs » J. Rancière, Le spectateur émancipé, Paris, La Fabrique, 2008, p. 66., dessinant ainsi un horizon essentiel pour (re)penser les politiques culturelles.
Entre les années 1960 et la fin des années 2000 s’est déployée une constellation de pratiques culturelles oppositionnelles et alternatives qui structure encore le paysage actuel. En 1971, des groupes de jeunes gens se mobilisaient pour la création de « centres autonomes » dans différentes villes de Suisse (à Zurich, Lausanne et Genève notamment). En exigeant l’ouverture de lieux autonomes, ces mouvements ont eu pour effet de souligner la condition spatiale des pratiques artistiques et ainsi de faire cohabiter des revendications culturelles et urbaines. À la suite de ces mobilisations, l’occupation de bâtiments vides se répand comme moyen à la fois de lutter contre la spéculation immobilière et de créer des espaces de liberté. Ces squats deviennent dès lors la condition d’espace d’un mouvement plus large de contestation existentielle, économique et politique, défendant de nouvelles formes de vie qui placent en leur cœur des idéaux d’autogestion, de participation et de créativité. Les luttes pour des « centres autonomes » et le « mouvement squat » auront eu pour effet de mêler production culturelle et production spatiale, prolongeant ainsi un projet plus ancien de décloisonnement de l’art et de la vie. Les Archives contestataires à Genève soulignent à juste titre que cette séquence se comprend mieux au regard des luttes précédant 1968, qui visaient à décloisonner la sphère du « travail (aliéné) » et celle des loisirs Archives contestataires, « Culture et contre-culture : les prémisses », 18 novembre 2021, consulté le 5 janvier 2022.. Ce projet de décloisonnement prendra toute sa force dans le déploiement de « lieux unitaires », comme les squats, mêlant vie quotidienne et travail artistique, espaces de diffusion et de fête.
Bénéficiant d’une relative tolérance de la part des collectivités publiques qui proposent des arrangements L. Pattaroni, « La ville plurielle. Quand les squatters ébranlent l’ordre urbain », dans M. Bassand, V. Kaufmannet, D. Joye (dir.), Enjeux de la sociologie urbaine, Lausanne, PPUR, 2007, p. 283-314., Genève devient, dans les années 1990, l’une des villes les plus squattées d’Europe, proportionnellement au même niveau que Amsterdam ou Berlin Ibid.. Nés dans une dynamique de culture oppositionnelle, les squats ont littéralement constitué une niche écologique des mondes de l’art selon une dynamique comparable à celle que décrivait Sharon Zukin à propos du quartier de SoHo S. Zukin, Loft Living: Culture and Capital in Urban Change, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1982. .

Saturation urbaine
Désormais, cette présence de la culture squat dans l’ordre urbain prend largement la forme paradoxale d’un motif politique. Autrement dit, ces lieux continuent d’avoir une importance cruciale dans le tissu culturel, tout en ayant physiquement largement disparu. En effet, durant la première décennie des années 2000, la plupart des squats ont été évacués sous la double impulsion d’une reprise du marché immobilier et de politiques sécuritaires. En parallèle, la « culture alternative » devenait une forme valorisée de la diversité culturelle promue par l’idéologie alors montante de la « ville créative ». Cette dernière recommandait d’attirer dans les centres urbains des individus considérés comme « créatifs » R. Florida, The Rise of the Creative Class: Revisited, New York, Basic books, 2012. – en réalité, les travailleur·euse·s de secteurs à forte valeur ajoutée. Visant autant à décrire une réalité qu’à proposer des recettes de management urbain, les textes fondateurs dévoilent cependant une absence criante de l’art et des artistes et mettent l’accent de manière univoque sur le caractère rentable de ces villes. Les stratégies de type « ville créative » – désormais en perte d’intensité – ont eu pour effet d’accélérer (et de révéler) le processus de métropolisation des politiques culturelles tout en accompagnant le processus (inachevé) de domestication des lieux alternatifs, c’est-à-dire leur inscription dans l’ordre économique de la ville capitaliste contemporaine.
Ainsi, le mouvement ambigu de répression et de valorisation s’est accompagné d’un effet d’encaissement Nous empruntons ici le concept d’encaissement à Joan Stavo-Debauge. Voir J. Stavo-Debauge, « Des “événements” difficiles à encaisser. Un pragmatisme pessimiste », dans L’expérience des problèmes publics, Paris, EHESS, 2012, p. 191-223. des lieux alternatifs subsistant dans l’économie urbaine et les contraintes normatives qui caractérisent les villes contemporaines. En effet, l’avènement des politiques néolibérales se caractérise par un gonflement des contraintes réglementaires et l’extension des domaines soumis au marché. Ce double gonflement suscite un étouffement urbain et mène à l’absorption des formes culturelles oppositionnelles et alternatives dans l’ordre de la ville. Afin de survivre dans ce contexte de saturation, plusieurs lieux ont fait le pari de l’institutionnalisation, et de formatage visant à les rendre compatibles « avec les normes – techniques, administratives, financières et culturelles – qui régissent l’ordre en commun à l’échelle de la ville » L. Pattaroni (dir.), op. cit.. Cette dynamique d’encaissement se manifeste d’un point de vue sémantique par le passage des termes « contre-culture » et « culture alternative » à celui de « culture émergente », nouvelle cible des politiques de subventionnement soucieuses d’assurer le maintien d’une scène culturelle diversifiée et attractive. Ce processus aboutit à l’avènement d’une « post contre-culture » qui conserve certaines formes, certaines modalités d’action et d’organisation, tout en abandonnant le projet politique oppositionnel et les luttes contre le capitalisme. Au contraire, les lieux culturels alternatifs – connaissant une nouvelle visibilité sous l’appellation très large de « tiers-lieux » – sont désormais largement associés aux politiques d’attractivité touristique et résidentielle des villes qui se veulent « créatives ». Néanmoins, les lieux culturels alternatifs portent aussi des possibles subversifs et, suivant leur configuration, sont capables d’infléchissements politiques ouvrant de nouvelles marges – d’expérimentation et d’hospitalité – dans les villes saturées.
Si la fermeture des squats et les processus d’institutionnalisation semblent avoir abouti à Genève, une nouvelle expérience a donné à voir des lignes de fuite semblant contredire le récit d’un encaissement à sens unique. En occupant un ancien bâtiment industriel au bord du Rhône – alors voué à devenir un centre pénitentiaire –, un collectif a obtenu gain de cause auprès des collectivités publiques (propriétaires du bâtiment) qui ont accepté l’idée d’affectation du bâtiment en centre culturel.

Le droit à la ville comme politique culturelle
Après un premier temps d’occupation, le collectif d’occupant·e·s a accepté d’évacuer le bâtiment et d’intégrer une commission aux côtés d’« expert·e·s » afin de dessiner le futur lieu culturel, tout en conservant provisoirement l’autogestion des abords du bâtiment. Ce premier geste d’encaissement – qui a transformé les occupant·e·s en « parties prenantes » d’un processus institutionnel où iels représentaient une voix parmi d’autres – s’est néanmoins accompagné du maintien d’un espace expérimental fort in situ, conjugué à une sphère de délibération sous tension. De fait, la rénovation du bâtiment devrait coûter plusieurs millions de francs suisses et il s’agit désormais de négocier entre, d’un côté, des formes de contrôle fortes et classiques et, de l’autre, la possibilité d’inventer des formes institutionnelles laissant davantage de marges de manœuvre à un projet fondé sur un idéal d’autogestion.
À cet égard, la commission a débouché non seulement sur la mise en place de dispositifs plus souples d’occupation des lieux, mais aussi sur une hybridation des compétences en matière de production coopérative de l’espace : les occupant·e·s transmettant leurs savoir-faire à l’ensemble de l’équipe (notamment en matière d’autoconstruction (DIY), de participations collaboratives, d’organisations horizontales, de solidarités), ainsi que les compétences techniques inhérentes à l’utilisation d’un bâtiment désaffecté. Par ailleurs, iels acquièrent des compétences de négociation, de participation, d’adaptation et de patience nécessaires à l’idéal participatif prôné dans les dispositifs de gouvernance.
Ignorant à ce jour quel sera le destin précis de ce lieu, il est notable que s’y soit déjà déployé un champ de possibles inédit, en particulier autour de l’idée qu’il importe de produire de manière incrémentale (sans planification forte) le lieu culturel à venir – ce qui est remarquable dans un bâtiment appartenant aux collectivités publiques. L’actuel processus est en effet mené étape par étape, au gré des négociations. En parallèle, l’occupation des alentours a fait subsister la dimension affirmative d’un « monde autre » : flotte encore contre une façade une banderole mentionnant « nous construisons un monde sans prison ». Outre son message, cette banderole est en soi le signe d’un déplacement de ce que l’on peut attendre de l’espace urbain. De surcroît, les lieux sont marqués d’interventions anonymes : un piano sur la berge, un lustre fixé dans le béton du porte-à-faux, l’inscription « chic et shlag » comme toponyme, un radeau avec roue à aubes (ayant servi lors de l’Occupation)… À cela s’ajoutent différents moments festifs et des chantiers collectifs qui ont ponctué la vie du site ces deux dernières années, le transformant en un véritable milieu d’expérimentation sociale et culturelle. Ainsi, l’expérience de ce lieu, tout comme son processus de production, laisse entrevoir un champ d’expériences esthétiques élargi, qui doit être pris en compte.
Ces expériences de luttes pour des lieux révèlent en creux une dimension cruciale des politiques culturelles et des politiques de l’art Nous entendons par « politiques culturelles » les actions des collectivités publiques en matière de promotion/définition de la culture, distinctes des « politiques de l’art », entendues ici comme l’efficacité de l’art en matière politique. Voir J. Rancière, Le spectateur émancipé, op. cit., présente dès leurs prémices : la dimension urbaine et spatiale des moyens d’émancipation par la culture. L’ouverture de lieux, d’équipements culturels et de centres est de fait au cœur de ces dispositifs ; et la production alternative de lieux rencontre leur visée émancipatrice. Outre le développement des individus et le décloisonnement de l’art et de la vie quotidienne, la production alternative de lieux comporte en soi une dimension émancipatrice ; et celle-ci souligne l’importance des processus de production comme composante des politiques de l’art. Il s’agit donc de penser l’espace de l’art non pas uniquement comme le contenant ou le cadre d’une expérience esthétique, mais comme vecteur de construction d’expériences collectives nourrissant la possibilité d’un monde commun. Dans cette perspective, l’enjeu politique dépasse l’alternative entre lieux institutionnels ou non – in ou off –, mais se tient dans la capacité que possède chaque lieu culturel de faire monde en infléchissant les formes dominantes, en s’ouvrant à des possibilités renouvelées d’autodétermination, des hospitalités accrues ou encore des lignes de fuite face aux captations capitalistes de l’art.
Article paru dans l’Observatoire no 59, avril 2022