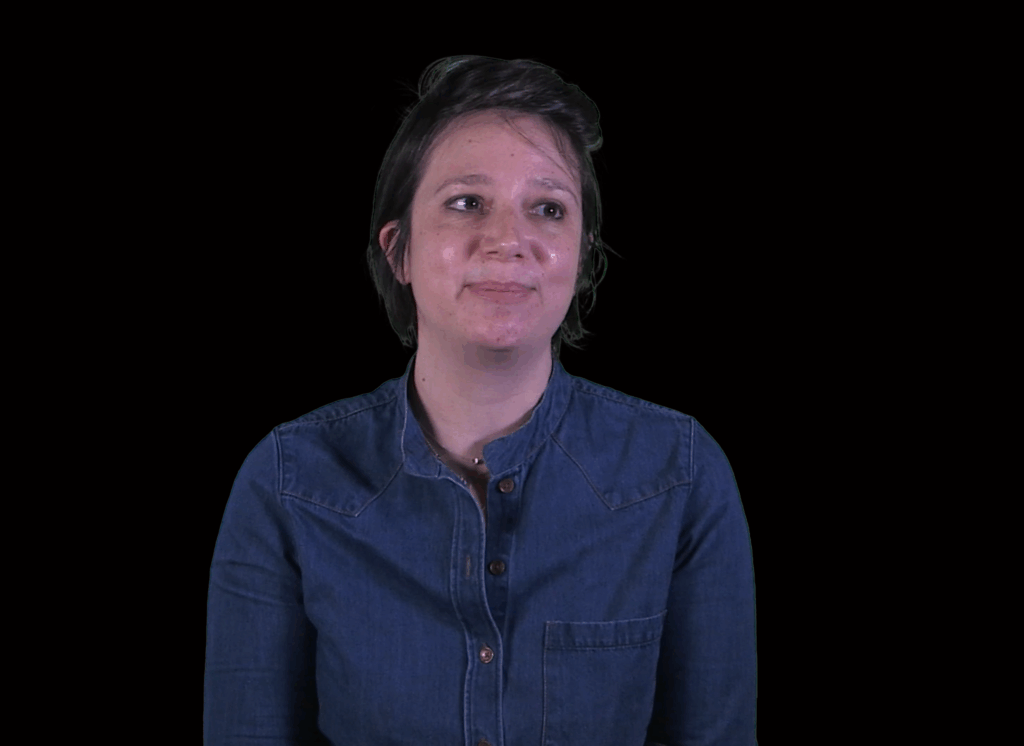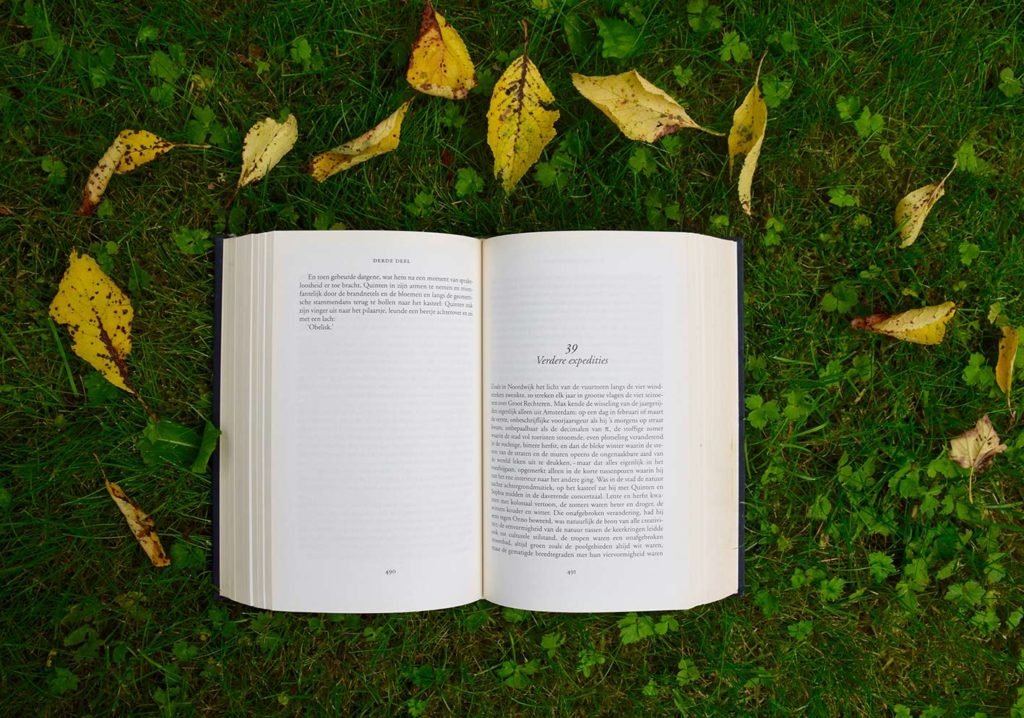La Poudrerie – Théâtre des Habitants est une scène conventionnée d’intérêt national « Art en territoire » pour la création participative. Valérie Suner, sa directrice, et l’équipe du théâtre ont mis au cœur des projets et programmations la notion de « participation ». Elles explorent de nouvelles façons d’accompagner et de produire des formes culturelles et artistiques pour permettre aux habitants et habitantes de se saisir de ce qui est en transition dans la société. Elles cherchent, avec les artistes accueillis, à produire des œuvres qui viennent raconter autrement des histoires d’aujourd’hui. À Sevran et à Kigali, Valérie Suner et Carole Karemera (avec l’Ishyo Arts Centre) actionnent les conditions d’une nouvelle rencontre avec le théâtre pour faire relation. Elles déplacent « le théâtre hors du plateau, dans les rues, les bibliothèques, les bars, les collines ou les habitations plus susceptibles de l’accueillir dans son essence, sa nudité M. Lombard, C. Karemera et V. Suner, « Pour un théâtre de proximité entre Sevran et Kigali : entretien avec Carole Karemera et Valérie Suner », Cahiers de littérature orale, no 89-90, 2021. ».
Pour sa Biennale dédiée à la création participative, La Poudrerie a associé, en 2022, l’Observatoire des politiques culturelles et Carole Karemera. Prolongeant ce qui a été initié lors de la précédente édition, l’idée est cette fois-ci d’engager une réflexion participative avec des artistes, des chercheurs, des publics, des habitants… pour faire le point sur les ressorts et les effets de la participation des publics dans la création artistique, décomposer l’ensemble des protocoles qui y prennent place, en tirer des idées-forces.
Ce questionnement croisé entre Sevran et Kigali entend aussi remettre en perspective les enjeux de la participation au regard des politiques culturelles. Peut-on dépasser l’objectif de démocratisation culturelle pour aller vers celui de démocratie culturelle ? L’ambition de démocratisation semble marquer aujourd’hui le pas, et les politiques culturelles cherchent de nouvelles réponses aux problématiques des périphéries en essayant de produire des espaces « communs » hors des centres et des structures traditionnelles. Toutefois, ce passage des politiques culturelles de la démocratisation vers la démocratie culturelle reste complexe, tant pour les artistes, les acteurs culturels que les institutions. Pendant presque cinquante ans, des actions culturelles centrées sur la rencontre avec l’œuvre et l’artiste ont été privilégiées, dans le dessein de permettre à toutes et tous d’y accéder. Même si les écarts tendent à se réduire pour certaines pratiques culturelles, force est de constater que cette mécanique de la démocratisation bute toujours sur les mêmes difficultés. Penser une participation dont l’assise serait la démocratie culturelle sous-entend de composer des actions à partir de la contribution de toutes et tous à l’expérience culturelle et artistique où les rôles et les statuts sont plus symétriques, pour reprendre un concept que porte l’anthropologue Philippe Descola. Cette approche convoque les droits culturels et met en avant des principes fondés sur l’identité, la communauté, l’égale dignité. Des mots et des notions qui font débat dans les milieux culturels et artistiques, et qui, pour être opérants, appellent aussi à dépasser les sillons disciplinaires que les arts ont creusés et à provoquer davantage de transversalité entre des formes culturelles.
La ville est la scène. L’œuvre est la partition. La participation est l’instrument.
La transversalité : un chantier permanent de démocratie culturelle
Susciter des liens et de la transversalité est donc devenu un chantier permanent d’expérimentation dans les projets que conduit La Poudrerie depuis 2019. Les passerelles sont jetées au-delà des champs artistiques classiques et s’incarnent dans des lieux qui portent d’autres cultures : un club de canoé-kayak pour une grande parade nautique, une usine qui recycle de la terre pour une œuvre sur nos origines, des appartements pour accueillir l’intimité des débats dans une famille sur les questions écologiques, des pieds d’immeuble pour imaginer des banquets… La ville est la scène. L’œuvre est la partition. La participation est l’instrument.
L’hypothèse travaillée par La Poudrerie est que la transversalité alimente les processus participatifs et de démocratie culturelle : elle relie les espaces, les sujets, les œuvres et les habitants. Elle connecte. Elle est un moyen de produire de la pensée. Elle augmente la capacité à construire des regards et des points de vue sur le monde, les autres, soi-même. Mais des interrogations demeurent : ces liens suffisent-ils à générer de la participation ? Regarder un sujet depuis une autre discipline peut-il produire un autre savoir et alimenter différemment la réflexion ? Si la transversalité engage la curiosité et la capacité à faire des « pas de côtés », elle semble être une condition nécessaire, mais non suffisante.
Aussi, Valérie Suner et Carole Karemera ont-elles exploré des formes possibles : elles ont proposé et animé à Kigali les ateliers « Où atterrir » conçus par Chloé Latour, au printemps 2022, puis ont participé aux Ateliers de la pensée à Dakar, pilotés par les deux penseurs et auteurs Felwine Sarr et Achille Mbembe qui cherchent à générer de nouvelles pensées sur la démocratie et les transformations sociétales depuis un regard porté par le Sud, affranchi des idéologies européano-centrées. Elles sont allées se nourrir de la « réserve de puissance », tel qu’Achille Mbembe nomme le continent africain dans son dernier ouvrage La Communauté terrestre, et ont puisé dans « les métaphysiques africaines du lien » : « Les sociétés africaines antiques étaient des sociétés ouvertes, plurielles et en mouvement. Autant elles avaient développé une conscience vive de la multiplicité des formes du vivant, autant elles faisaient une large place à la diversité des comportements et à la thématique de la singularité A. Mbembe, La Communauté terrestre, Paris, La Découverte, 2023.. » Une expérience de pensée et de relations humaines qui les a fait se déplacer, tant physiquement, géographiquement que culturellement, et qui est venue renouveler la possibilité de réfléchir à la participation. Se déplacer, c’est se mouvoir et s’émouvoir.
Faire l’expérience du déplacement
Elles ont alors souhaité mettre en travail cet exercice du déplacement lors de la Biennale, en le déployant dans cinq directions qui ont servi de canevas au processus de programmation et aux propositions faites aux publics : se déplacer physiquement, artistiquement, entre les disciplines, politiquement et intimement.
Chaque proposition artistique a pris place dans plusieurs quartiers de Sevran et dans des lieux choisis pour leur résonance avec le sujet des différentes créations, invitant les participants à une itinérance à travers la ville : « Alors que d’ordinaire, c’est La Poudrerie qui va jouer chez l’habitant, nous avons fait le choix de déplacer les œuvres, et donc les gens, dans des lieux non consacrés afin de nous questionner ensemble sur ce que cela produit » dit Chloé Bonjean, chargée des relations publiques. La programmation s’est également nourrie de la transversalité engagée à travers les projets croisant art, science, sport, écologie… et a misé sur la rencontre avec une variété d’esthétiques et de formes (spectacle musical, théâtre à domicile, performance poétique, création radiophonique, film, etc.). Quatre jours de Rencontres durant lesquels chaque représentation était suivie d’ateliers et d’échanges pour se pencher sur ce qu’elle suscite ou fait bouger : comment nous sentons-nous engagés en tant que citoyens dans la relation à l’œuvre ? Qu’est-ce que cette expérience provoque ?
Au terme de ce processus, l’heure était donc à la réflexion collective afin d’interroger ce qui s’était produit en chacun et le mettre en partage avec tous, en invitant les artistes, les chercheurs·euses, les élu·e·s, les publics et les partenaires à commenter ces ressentis. La salle des fêtes de Sevran s’imposait pour ce temps rassembleur, en tant que lieu culturel « tiers » (ou tiers-lieu avant l’heure ?) essentiel aux politiques culturelles locales, où convergent les événements et actions culturelles à destination des habitants, sans distinction, de la fête patronale aux pièces de théâtre, du spectacle de l’école aux mariages, du conseil municipal à l’exposition de peinture, du carnaval aux rencontres savantes.
Dans la synthèse des échanges issus des ateliers, on se rend compte de ce qui a été tracé : « assister à une représentation dans des lieux non consacrés (le hangar du jardin biologique, l’usine de briques en terre crue, etc.) crée un déplacement dans la réception d’une œuvre et permet de la voir différemment. Les temps de partage tels que celui du banquet de L’Odyssée ont offert aux personnes la possibilité de se raconter, de se lier et se connecter à d’autres quartiers, d’autres cultures et d’autres âges. Il ressort aussi que ce déplacement est celui de la transmission vers les générations futures (renouer avec des traditions orales ou un savoir ancien, transmettre un héritage culinaire, etc.). Enfin, un déplacement a lieu à l’écoute des autres points de vue (notamment ceux du monde non-humain). C’est se sentir concerné par le monde qui nous entoure, partir du local pour aborder des questions plus universelles. Ce que l’un des participants résume en disant qu’il a appris en 2 heures de temps, ce qu’il n’a pu apprendre en 72 ans de vie ! », relate Chloé Bonjean.
Prêter collectivement attention à ces déplacements est en soi un moment de démocratie qui, s’il n’aboutit pas à des décisions ou des délibérations, ouvre néanmoins un espace de dialogue fondé sur une expérience. On pense ici aux mots de Cynthia Fleury : « L’expérience, c’est ce qui nous protège de la fascination pour la certitude, du besoin maladif de certitude, c’est ce qui fait comprendre que la connaissance et incertitude et faillibilité travaillent de concert C. Fleury, Le soin est un humanisme, Paris, Gallimard, 2019.. » Faire l’expérience ensemble de ce que chacun a vécu de ces œuvres est une façon d’aboutir le processus même de ces créations participatives. Il s’est passé quelque chose d’important ce samedi matin dans la salle des fêtes de Sevran : un théâtre de la participation est peut-être devenu un théâtre de la contribution. Et s’agissant de démocratie culturelle, cela en constitue certainement l’un des premiers actes.
Les captations de toutes les interventions de la matinée, éditorialisées par Benoît Labourdette, sont sur le site de La Poudrerie.