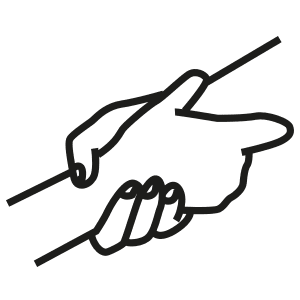[Article initialement paru dans l’Observatoire no 62, juillet 2024]
L’Observatoire : À quoi fait-on référence lorsque l’on parle de théâtre public et surtout d’un théâtre « de service public » ?
Pascale Goetschel : Il faut commencer par souligner que l’appellation « théâtre public », en France, ne se limite pas aux seuls théâtres nationaux ou centres dramatiques nationaux, mais englobe également toutes les scènes soutenues par l’État et les collectivités territoriales, sans compter la multitude de compagnies qui font aussi œuvre de service public. Le théâtre dit « de service public », tel que nous l’entendons actuellement, répond à une double fonction, à la fois artistique et civique : rendre possible la création dramatique, supposée de qualité, et travailler à sa diffusion au sein de la société. Il s’est forgé au fil des ans contre le théâtre commercial, lucratif, trop lié à la seule fonction de divertissement des masses, et cela a justifié l’octroi de subventions.
Cependant, le « théâtre public » peut aussi être envisagé de manière plus complexe. Pourquoi ? Parce qu’en France, au XVIIe siècle, existaient des théâtres de prestige qui bénéficiaient déjà de subsides de l’État royal, puis des théâtres jouissant du système du privilège – ce qui signifie qu’ils étaient les seuls à pouvoir pratiquer un théâtre parlé ou chanté dans un système hiérarchisé –, entre 1806-1807 et 1864, sans que le soutien financier ne préjuge du caractère de service public.
On peut d’ailleurs lire toute la première partie du XIXe siècle comme une lutte des petits théâtres contre les théâtres dits privilégiés Voir J.-Cl. Yon, Une histoire du théâtre à Paris. De la Révolution à la Grande Guerre, Paris, Aubier, 2012.. Il y a aussi, tout au long du XIXe, quantité de théâtres municipaux, très populaires dans les villes, qui remplissent déjà une forme de « service aux publics » en offrant l’accès à des spectacles variés tandis que des tentatives de « théâtres populaires », en particulier depuis les années 1860 et davantage dans les années 1890-1900, se multiplient. Après la Première Guerre mondiale, si nombre de salles se sont transformées en cinémas, la recherche d’un « théâtre public » passe par différents biais – subventions d’État à un niveau modéré, politiques municipales, mouvements d’éducation populaire… – tandis que demeurent des théâtres nationaux de prestige.
L’institutionnalisation d’un théâtre public est donc bien antérieure à ce qui se passera après la Seconde Guerre mondiale avec la création des centres dramatiques nationaux Voir P. Goetschel, « Le “service public du théâtre” : une histoire française », dans L’Artiste, l’administrateur et le juge. L’invention du service public culturel. Le rôle du Conseil d’État, Colloque, Paris, Conseil d’État et Comédie-Française, 26 et 27 novembre 2021, Comité d’histoire du ministère de la Culture, Éditions La Rumeur libre, 2023, p. 99-120..
Emmanuel Wallon : Effectivement, les débats sur l’importance d’un théâtre accessible au peuple et la nécessité d’une offre soutenue par l’État et les collectivités locales remontent bien avant la « décentralisation dramatique » impulsée par Jeanne Laurent sous la IVe République Voir S. Nicolle, La tribune et la scène. Les débats parlementaires sur le théâtre en France au XIXe siècle (1789-1914), thèse de doctorat sous la direction de Jean-Claude Yon, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2015.. Ce sont néanmoins les déficits récurrents ou persistants qui ont incité les milieux artistiques et certains représentants du monde politique et administratif à se réclamer de la notion juridique de service public, illustrée ensuite avec panache par une personnalité telle que Jean Vilar J. Vilar, Le Théâtre, service public, Paris, Gallimard, 1975.. Mais la reconnaissance du caractère public d’une activité économique passe par la démonstration de son intérêt général, d’une utilité sociale qui requiert la contribution de tous à l’entretien de ce service. Construire la légitimité de la subvention implique de la justifier. Il ne suffit plus d’invoquer l’intérêt général en son principe, il faut démontrer qu’il se concrétise dans l’activité même, à commencer par la réunion d’un large public. Le fondement de cette exception au droit commun repose sur deux types de critères : le premier est celui de l’excellence, plus exactement de la prévalence des « intérêts artistiques sur les intérêts commerciaux de l’exploitation », introduit dans l’arrêt Léoni du Conseil d’État CE, 21 janvier 1944, sieur Léoni. ; le second est évidemment le caractère le plus étendu et le plus divers du public auquel il se destine.
Les tenants d’un théâtre de service public ont parfois joué jusqu’à l’excès de la magie des mots. Parler de « théâtre public » (plutôt que « subventionné » ou « subsidié ») permet de concentrer tout un champ sémantique en combinant, d’un côté, ce qui relève de la responsabilité publique de l’État ou de la collectivité et, de l’autre, ce qui suggère l’assistance au spectacle, le public physique. Cette polysémie a bien des avantages dans une ère où le théâtre perd la position centrale qu’il occupait au cœur de la vie sociale mais veut s’affirmer porteur d’une mission salvatrice pour la conscience commune.
Quand on prête au théâtre la qualité d’être un « art politique », est-ce sa vocation à rassembler qui est en jeu ?
P. Goetschel : Le théâtre comme art de la polis comporte une dimension civique, régulièrement convoquée en référence à l’Athènes classique, parce qu’elle permet de facto de produire de l’institution théâtrale. Ce seront, à la fin du XIXe, les petits théâtres populaires qui prolifèrent en banlieue, puis le fameux Théâtre du peuple à Bussang, le Théâtre national populaire de Firmin Gémier au Palais du Trocadéro en 1920 qui, lui-même, succède au Théâtre national ambulant, etc. Fort de cet idéal de vouloir apporter le théâtre au peuple, les pouvoirs publics, sous le Front populaire, proposent des formes inédites de soutien gouvernemental, telles que des aides à quelques troupes produisant du théâtre radiodiffusé au moment de l’Exposition internationale de 1937. En 1936, dans la grande enquête de Comoedia, « À temps nouveaux, arts nouveaux », les auteurs, essayant de concevoir ce que pourrait être ce théâtre de rassemblement, ont proposé des orientations diverses : privilégier le théâtre ambulant ou de plein air, jouer les œuvres dramatiques dans de très grandes salles (par exemple au Vel’ d’Hiv’), imaginer, comme Charles Dullin, des « préfectorats artistiques ». Donc, avant même le TNP de Vilar et la création des centres dramatiques nationaux en 1946, existe cette idée que le théâtre est l’art du rassemblement.
Les tenants d’un théâtre de service public ont parfois joué jusqu’à l’excès de la magie des mots.
Mais, en arrière-plan, demeure toute l’ambiguïté du mot « peuple ». Qui désigne-t-on ? Le plus grand nombre ? Les classes populaires à éduquer politiquement ? La communauté locale ou nationale rassemblée ? Le mélange des groupes sociaux ? Le public ouvrier ? Rappelons que, même au temps des centres dramatiques nationaux, celui-ci n’était pas majoritaire. C’était plutôt un public de classes moyennes portées par l’essor des métiers du secteur tertiaire, en lien avec la montée en puissance de la scolarisation secondaire et supérieure. L’élan culturel accompagnait l’élan social. Or, depuis plusieurs décennies, existe une sorte de nostalgie pour un public populaire que l’on aurait perdu et qui aurait été présent aux débuts de ce théâtre de service public. Il y a là une mythologie des premiers temps du « service public » d’après-)guerre, non dénuée d’ambiguïté.
E. Wallon : L’ambiguïté à cet égard s’approfondit à l’époque actuelle, car c’est justement quand il devient difficile de cerner le peuple, de le définir socialement et statistiquement, de l’identifier à un récit qui le ferait coïncider avec la nation, que l’on invoque plus bruyamment son nom. C’est pourquoi les discours qui déplorent la perte de la vocation populaire du secteur subventionné sonnent un peu faux à mes oreilles. Ils idéalisent ce que furent ces institutions – y compris dans les années glorieuses de la décentralisation dramatique –, mais ils fantasment aussi un peuple qui subsumerait les différences, les catégories et couches qui le composent.
Sous la Ve République – de Malraux à Lang et même au-delà, à travers la reprise des thèmes de démocratisation et de décentralisation – les metteurs en scène du théâtre public ont assumé un rôle plus général dans la promotion de l’idée d’un service public de la culture. Leurs écrits et discours les posèrent en défenseurs d’une mission civique de premier plan, visant à accomplir, dans le domaine de l’art, ce que la IIIe République avait entrepris en matière d’éducation. De nos jours, ce sont les programmateurs placés à la tête des scènes nationales, des scènes conventionnées, des théâtres de ville ou d’autres structures labellisées qui endossent cette fonction tribunitienne, consistant à rappeler la responsabilité de l’État et à interpeller les élus territoriaux lorsqu’ils empiètent sur l’autonomie des artistes ou qu’ils réduisent leurs aides à la création. Ils redoublent d’alarmes à l’heure où le ministère de l’Économie et des Finances impose des coupes budgétaires drastiques.
Comment qualifieriez-vous le moment de crise que traverse actuellement le théâtre public ?
E. Wallon : La crise revêt tout d’abord un aspect existentiel, spectaculairement révélé par la pandémie de Covid-19, lorsque le caractère essentiel ou inessentiel de certaines activités fut mis en examen. Le fait que la « culture sur canapé », trustée par les services de vidéo à la demande, ait continué de progresser dans d’importantes proportions à la suite des confinements a amplifié l’angoisse des professionnels du spectacle quant à la place occupée par leurs disciplines (théâtre, danse, arts du cirque et de la rue, marionnettes…), qui impliquent non seulement de sortir et de se réunir, mais aussi d’investir des espaces publics. Grâce aux subventions, les lieux de spectacle ont moins pâti de leur fermeture que les compagnies indépendantes, la chair vive de ce marché, dont la production fut entravée et la diffusion bloquée, ce qui a aggravé les disparités au sein du milieu. La perception de cette menace vitale a peut-être alimenté un phénomène de surpolitisation. Pour montrer que l’on touche bien à l’essence du politique quand on évoque le destin de la cité sur une scène de théâtre, grande est la tentation de mettre en avant les questions brûlantes du moment : les inégalités sociales, les méfaits de la domination masculine, le contexte postcolonial, les revendications identitaires, la condition des migrants, etc. Il y aurait lieu de s’en féliciter sans frein si la fonction critique et la dimension poétique de la pratique théâtrale n’étaient pas parfois sacrifiées sur l’autel de la didactique.
Le deuxième élément est d’ordre structurel : les marges artistiques s’amenuisent du fait de la croissance des coûts fixes. Celle-ci accentue la fragilité intrinsèque du théâtre, en tant qu’activité présentielle reposant essentiellement sur le capital humain. Sa facture artisanale l’expose plus que d’autres branches à la surchauffe inflationniste. Le renchérissement des prix de l’énergie, des assurances et autres prestations de service a des répercussions immédiates sur l’entretien d’un théâtre « en ordre de marche » dont la scène doit être éclairée, la salle chauffée, l’équipement vérifié, le personnel disponible avant même que le spectacle ne débute.
Le dernier facteur est plus conjoncturel : les 96 millions d’euros soustraits au programme 131 de la mission Culture du budget de la nation représentent un coup de rabot de 10 %, nettement supérieur aux économies de 7 % en moyenne que Bercy a imposées à l’ensemble des ministères. Ces coupes vont toucher directement l’emploi, la professionnalisation des jeunes compagnies et compromettre le plan « Mieux produire, mieux diffuser » de la DGCA Ce plan, présenté par la Direction générale de la création artistique (DGCA) du ministère de la Culture au Conseil national des professions du spectacle (CNPS), en juin 2023, finalisé en décembre 2023, au terme d’une consultation nationale, repose sur un principe de financement paritaire avec les collectivités territoriales. Un renforcement budgétaire du plan a été annoncé le 3 mai 2024 par la ministre de la Culture, Rachida Dati à hauteur de 8,6 millions d’euros (les collectivités territoriales investissant 13,4 millions d’euros) pour un montant global de 22 millions d’euros., au point qu’une association d’administrateurs prévoit pour la saison 2024/25 une baisse de 54 % du nombre de représentations « Enquête flash » auprès des adhérents de l’Association des professionnels de l’administration du spectacle (LAPAS), publiée le 27 mars 2024.… Elles auront aussi inévitablement des conséquences sur l’ajustement des salaires. Tout l’écosystème du spectacle vivant en est ébranlé, comme l’ont exprimé les organisations professionnelles du spectacle dans leur communiqué commun du 14 mars.
P. Goetschel : Je vais sans doute être un peu provocatrice, mais j’aurais tendance à dire que les théâtres subventionnés ne sont pas les seuls à être concernés par cette crise. L’hôpital, l’enseignement secondaire ou supérieur traversent des difficultés comparables, si ce n’est pire : des coupes budgétaires, une politique globale d’objectifs, une hausse des coûts, des règles liées à l’accueil des publics, des injonctions contradictoires, le sentiment d’être pris dans l’étau de contraintes administratives… tout cela révèle, à mon avis, une crise plus large qui touche à la question des services et des vocations (notamment des métiers en lien avec des publics).
Aussi, pour identifier ce qui singularise le moment actuel que traverse le théâtre et ne pas tomber dans une sorte de discours essentialisant sur une « crise du théâtre public », il faudrait prendre en compte un ensemble de facteurs. Certes – et Emmanuel Wallon l’a mentionné –, le secteur connaît de fortes contraintes budgétaires : coûts de production des spectacles, hausse du prix des fluides, sécurisation des salles… Cependant, le développement de pratiques scéniques et de dispositifs de diffusion alternatifs a une double conséquence. Il apparaît, d’une part, comme une concurrence objective avec, par exemple, la possibilité de regarder la captation d’une pièce de théâtre depuis chez soi ou le déploiement d’autres expressions artistiques qui peuvent mettre en question la place des textes et des metteurs en scène. Il constitue, de l’autre, une opportunité, à l’instar de la mobilisation des institutions publiques pour mettre à disposition sur la « toile » (le web) leurs spectacles ou de dispositifs numériques incitatifs pour acheter des places sans réservation et à moindre coût.
Justement, arrêtons-nous sur ce « discours de crise ». Pascale Goetschel, vous avez montré, dans l’un de vos ouvrages P. Goetschel, Une autre histoire du théâtre. Discours de crise et pratiques spectaculaires, Paris, CNRS Éditions, 2020., qu’à la fin du XIXesiècle, on évoquait déjà une « crise du théâtre ». Faut-il en déduire que le théâtre est perpétuellement en crise ou bien que cette période marque un moment de bascule quant à la place qu’il occupait dans la société ?
P. Goetschel : Cette expression de « crise du théâtre » a effectivement surgi dans les années 1890, dans des pamphlets, des essais, des articles de journaux, mais aussi au sein de causeries faisant le diagnostic d’une situation prétendument désespérée du théâtre en France, en particulier à Paris, alors que celui-ci se portait plutôt bien. Qu’est-ce qui se joue à ce moment-là ? Plusieurs éléments entrent en ligne de compte : des luttes esthétiques au sein du champ théâtral, entre naturalisme et symbolisme notamment Chr. Charle, La Crise littéraire à l’époque du naturalisme. Roman. Théâtre. Politique. Essai d’histoire sociale des groupes et des genres littéraires, Paris, Presses de l’ENS, 1979. ; des enjeux économiques liés à un secteur théâtral en pleine mutation qui passe de l’artisanat à une production quasi industrielle ; et enfin, de nouvelles formes de spectacle ou de divertissement qui font concurrence au théâtre : le music-hall (dans les années 1880 et 1890), le cinématographe à la charnière des XIXe et XXe siècles, la radio, les spectacles sportifs. Pour Jean-Claude Yon, on assiste à la perte du pouvoir symbolique du théâtre, à l’effacement de la « dramatocratie J.-Cl. Yon, Une histoire du théâtre à Paris. De la Révolution à la Grande Guerre, op. cit. » qui prévalait lorsque le théâtre était au cœur de la vie publique et participait fortement à la constitution de l’opinion. De mon côté, j’insiste davantage sur les mutations des loisirs et le caractère peu à peu jugé problématique de la sortie au théâtre, fustigée pour être trop mondaine, trop parisienne, avant d’être parfois considérée comme démodée à partir des années 1920.
Dénoncer une prétendue « crise du théâtre » au moment où celui-ci est à la fois florissant esthétiquement et économiquement a, en réalité, plusieurs fonctions. Le fait d’entretenir le débat sur la présumée maladie du théâtre illustre tout d’abord une manière de se positionner dans le champ politique, en particulier dans les extrêmes : à la gauche de l’échiquier politique, le goût du théâtre est assimilé à une addiction maladive et la critique porte sur l’embourgeoisement du théâtre L. Legavre, La Théâtromanie, Paris, Marcel Rivière, Mons, Imprimerie générale, 1910. ; à l’extrême droite, chez les monarchistes, on dénonce un théâtre mercantile et juif menant la IIIe République à son déclin Voir Léon Daudet, journaliste nationaliste, monarchiste et antisémite, série d’articles intitulée « Le krach des théâtres » et parue dans L’Action française en avril et mai 1914.. En complément, il faut signaler la fonction morale de ces représentations de crise : dénoncer un théâtre prétendument dégradé sur le plan esthétique, dépravé et économiquement corrompu, c’est aussi se situer sur le terrain des valeurs (la nation, le beau, les bonnes mœurs…). Ce discours a, d’autre part, une fonction sociale et socioprofessionnelle, agissant comme un révélateur des inégalités à l’œuvre au sein du monde des spectacles : on critique les nantis, en particulier les vedettes et les directeurs de salle ; on reproche aux auteurs leur absence de métier, etc. Enfin, ce discours de crise a une fonction symbolique (dans les dernières décennies du XIXe siècle), consistant à se réclamer du populaire et qui conduit à transformer les conditions de représentation. Les uns souhaitent jouer leurs œuvres devant le public du « petit Paris », du « Paris qui travaille » et promeuvent des initiatives de théâtres populaires, les autres valorisent le plein air, la province et le contact avec la population locale, comme au Théâtre de Bussang, dans les Vosges, fondé en 1895. Cette situation est d’autant plus paradoxale que la défense d’un « public sain », d’un « vrai public » (ou d’un théâtre « décabotinisé » comme le nommerait Copeau) a lieu le plus souvent au sein d’un petit monde masculin, littéraire et parisien.
En conclusion, l’hypothèse peut être avancée que ce discours de crise a une fonction implicite : celle de contribuer à faire perdurer le théâtre comme secteur, dans une forme d’essentialisation qui gomme les diversités de situations et de statuts. En parler, c’est le faire exister. De ce point de vue, il y a des éléments de comparaison avec ce qui se passe aujourd’hui.
E. Wallon : Si le petit monde parisien des lettres, à la charnière des XIXe et XXe siècles, se passionne autant pour la question théâtrale, c’est aussi parce que la scène est l’endroit où il rencontre vraiment la société. À travers l’espace de la salle, l’écrivain passe des quelques milliers de lecteurs d’un roman aux centaines de milliers de spectateurs d’une pièce à succès, de sa chambre aux salons, cafés et restaurants où se répandent les débats suscités par un mot d’auteur ou un geste d’acteur. C’est là aussi que se nouent des carrières qui ne sont pas seulement littéraires, mais également sociales, voire entrepreneuriales, et parfois politiques. Ainsi que Pierre Bourdieu l’a analysé à propos du cas de Flaubert P. Bourdieu, Les Règles de l’art, Paris, Seuil, 1992., prescrire des critères de jugement permet d’asseoir des positions dominantes au sein d’un champ de l’art. Certaines logiques de pouvoir internes au champ théâtral dépassent largement ses frontières et s’étendent à d’autres domaines d’exercice de l’autorité.
On voit également, dans ce que vient de rappeler Pascale Goetschel, que le théâtre procède à la mise en scène de tensions, de conflits et de mouvements qui travaillent la société dans son ensemble comme dans ses cercles les plus intimes. Sous le concert des cris d’alerte, au cours du XIXe et d’une bonne partie du XXe siècle, il faut déceler la manifestation d’une contradiction inhérente à la représentation publique. Les approches divergent. Pour les tenants d’un théâtre d’art, autour de Jacques Copeau, il s’agit d’une crise esthétique : les complaisances du théâtre de boulevard dégradent le goût du public au lieu de l’élever, elles abaissent aussi l’art des acteurs qui se vautrent dans le cabotinage. Pour les tenants d’un théâtre populaire, autour de Maurice Pottecher, Henri Barbusse, Romain Rolland, Firmin Gémier, c’est une crise morale et politique : le spectacle commercial distrait les élites et délasse les masses, alors qu’il faudrait éduquer celles-ci et responsabiliser celles-là.
Il est frappant de constater à quel point ces discours désaccordés se rejoignent dans leur souci d’essentialiser le théâtre. On ne parle pas des théâtres ou des arts de la scène au pluriel, pas plus qu’on ne distingue les disciplines et les genres ; on voudrait que le Théâtre avec « un grand T » se comporte comme ceci, s’écrive comme cela, se joue devant une audience à la fois représentative de la société dans sa globalité et capable d’arbitrer les élégances à la façon de l’aristocratie académique d’autrefois. Cette essentialisation a évidemment pour effet, sinon pour but, de masquer les différences et les divisions.
Diriez-vous que le théâtre a perdu de sa centralité, au regard d’autres pratiques, d’autres domaines de créativité artistique, esthétique et intellectuelle ? Qu’est-ce qui fait sa singularité aujourd’hui ?
P. Goetschel : Si l’on prend comme point de référence le XIXe siècle et cette fameuse « dramatocratie » décrite par Jean-Claude Yon, alors effectivement le théâtre a perdu une centralité politique et presque mondaine. Mais, selon moi, tout dépend où on la situe. Si on la rapporte à Paris et aux prétendues élites qui se détourneraient du théâtre, alors peut-être, en effet, que celui-ci n’est plus aussi central. Il ne l’est plus, ou l’est moins, comme loisir urbain ou comme référence artistique. En revanche, si on décentre un peu le regard vers ce qui se passe dans les périphéries et sur l’ensemble du territoire où de petites compagnies nourrissent quantité de propositions, ou vers des formes de spectacles plus modestes (tels que les seuls en scènes) qui ne sont pas forcément présentes dans les grandes institutions, alors le repère pour fixer cette centralité n’est plus le même. Deviennent importants de multiples lieux où se fait du théâtre – théâtres amateurs, y compris en milieu scolaire, « tiers lieux », fêtes et festivals – autrement dit, toute une série d’espaces publics, associatifs, éducatifs ou militants, dans lesquels la forme dramatique, le spectacle vivant, a toute sa place. Il s’agit d’une autre manière d’appréhender le « théâtre public » caractérisé là par une indéniable vitalité.
Le monde des spectacles sert un peu de marqueur ou d’étalon pour réfléchir aux problèmes sociaux.
Il est surtout intéressant de relever un paradoxe : c’est au moment où le monde du théâtre connaît une crise existentielle que se manifeste une certaine centralité de l’expression des gens de théâtre. Je pense, par exemple, au rôle important que les intermittents ont joué dans une réflexion plus générale sur le monde du travail dans les années 2000, ou à celles et ceux Notamment Denis Gravouil, autrefois à la tête de la Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l’audiovisuel et de l’action culturelle (FNSAC-CGT). qui ont donné de la voix, plus récemment, sur la protection sociale et les retraites. De ce point de vue, il me semble que le monde des spectacles sert un peu de marqueur ou d’étalon pour réfléchir aux problèmes sociaux : formes diverses de précarité et moyens d’y remédier, souffrance au travail, égalité professionnelle, droits des travailleurs, prise en compte des transformations du travail liées à l’essor des nouvelles technologies de l’information et de la communication…
Enfin, l’univers théâtral, marqué par une hybridité de plus en plus forte des formes – de la danse à la vidéo, en passant par une série d’expériences acoustiques ou plastiques –, constitue à mon sens un prisme remarquable pour penser les mutations, voire les catastrophes, contemporaines. Le temps d’une représentation, les spectateurs et spectatrices assistent, collectivement, hors de leurs murs quotidiens, au spectacle du monde, comique ou tragique, banal ou extraordinaire. Dans cette mise en commun, il y a là une vraie singularité. À défaut de détenir une place centrale dans les usages du temps libre, la manifestation théâtrale joue donc sa partition dans les multiples tentatives de démêler l’écheveau complexe du monde, en un mot dans la quête de sens.
E. Wallon : Le théâtre a indubitablement subi une perte de centralité sociale. Le constat vaut pour des élites économiques qui préfèrent consacrer leurs sorties aux vernissages des galeries et foires d’art contemporain, où ils apprécient des valeurs négociables et même thésaurisables, ainsi que des indices de prestige transférables sous forme de capital symbolique, dont on peut faire ostentation. Il vaut encore dans le reste de la population, en raison de la concurrence exacerbée des divers vecteurs de diffusion numérique, des autres manifestations spectaculaires, du cinéma aux réseaux sociaux en passant par la télévision, les jeux vidéo et l’écoute de musique en ligne. En revanche, jamais nous n’avons compté autant de festivals et de théâtres subventionnés en France. Jamais l’art dramatique n’a autant été étudié dans les conservatoires et les universités. Jamais autant de brèches n’ont été ouvertes pour faire pénétrer sa pratique dans l’Éducation nationale – même si c’est souvent avec des moyens trop limités ou des objectifs pédagogiques un peu flous. Et jamais autant d’objets de théâtre n’ont été intégrés dans les fonds patrimoniaux (archives, bibliothèques, musées, banques de données, Centre national du costume de scène à Moulins, etc.).
Le contraste est frappant. En cumulant tous ces désavantages dans la sphère de la communication, le monde des arts de la scène prend paradoxalement conscience qu’il demeure au cœur des enjeux de présence et de relation, de mise à l’épreuve du réel et de mise en examen de la véracité, de confrontation entre les interprétations opposées. Quand tout s’expose au doute, devant la multiplication des fake news, la montée en puissance des intelligences artificielles, l’atomisation des opinions enfermées par des algorithmes dans des bulles et des niches, le théâtre, de manière artisanale et expérimentale, offre des solutions de recherche et de confrontation qui peuvent apparaître sinon comme des antidotes à la désinformation, du moins comme des stimulants pour faire face à ce nouvel état des lieux. En conséquence, sans doute parviendra-t-il à tirer son épingle du jeu d’une crise civilisationnelle bien plus ample que la sienne, que l’on pourrait qualifier de « dissociation de la représentation ».
En revisitant la place du texte, le rôle de la parole et le statut de l’image, l’art dramatique part certes à la rencontre d’autres modes d’expression. Explorer les lisières entre les arts permet de sonder les marges du sens commun, de fouiller les zones troubles de la conscience. Sa singularité consiste en l’exposition sensible aux idées, aux concepts, mais aussi aux affects. En un mot, les théâtres (en dur, en toile ou au grand air) aménagent des espaces-temps d’altération. C’est-à-dire qu’il n’est pas possible de prendre part à la séance sans être soi-même impliqué dans un échange intersubjectif qui va littéralement affecter, altérer la représentation des autres, mais aussi l’image de soi. C’est la raison pour laquelle la pratique théâtrale joue fréquemment un rôle de révélateur chez des adolescents en pleine construction identitaire. C’est aussi pour cette raison que des artistes échafaudent sur les plateaux des stratégies fragiles, incertaines, de lutte contre l’indifférenciation généralisée, de résistance à l’indifférence qui gagne au spectacle télévisé ou à l’étalage, sur les réseaux numériques, de souffrances de masse dont on cherche d’ordinaire à se soustraire ou à s’abstraire. Au théâtre, cette retraite est pratiquement impossible.